|
|
Aujourd'hui, la République paraît bien établie en France.
Pourtant, ce régime politique a fait son apparition en 1792
seulement. Et il ne s'est imposé que depuis une centaine d'années.
L'histoire
La Première République naît pendant la Révolution
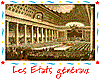
En 1789, les représentants de la population française - noblesse, clergé
et tiers état - se réunissent à
Versailles pour exprimer leurs doléances au roi de France. C'est le
début de la Révolution française. Le 20 juin 1789, les
délégués du Tiers jurent qu'ils ne se quitteront pas avant
d'avoir donné une Constitution à la France. Sur le modèle
de l'Angleterre, ils veulent que la politique du roi puisse être
contrôlée par les élus du peuple français. Ainsi
sont votés l'abolition des privilèges (nuit du 4 août 1789)
et la Déclaration des droits de l'Homme (26 août 1789).
 Louis XVI accepte en apparence. En réalité, ni lui ni les
puissants du royaume ne souhaitent ces changements. En 1792, le roi tente de
s'enfuir; il est rattrapé à Varenne. On cesse de lui faire
confiance, d'autant que la guerre contre une alliance de rois étrangers
menace Paris. Le 20 avril 1792, lors de la bataille de Valmy, les
révolutionnaires battent le roi de Prusse. Le lendemain, la
République est proclamée. Désormais, le roi n'exerce plus de pouvoir.
Louis XVI accepte en apparence. En réalité, ni lui ni les
puissants du royaume ne souhaitent ces changements. En 1792, le roi tente de
s'enfuir; il est rattrapé à Varenne. On cesse de lui faire
confiance, d'autant que la guerre contre une alliance de rois étrangers
menace Paris. Le 20 avril 1792, lors de la bataille de Valmy, les
révolutionnaires battent le roi de Prusse. Le lendemain, la
République est proclamée. Désormais, le roi n'exerce plus de pouvoir.
Une République bien instable
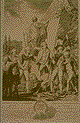
La Première République est née. Elle crée
les départements et le suffrage universel... pour les hommes seulement.
Elle condamne aussi Louis XVI à mort pour trahison; il est
exécuté le 21 janvier 1793. Mais elle est déjà
divisée. A la Convention, l'assemblée qui décide de la
politique française, deux partis se querellent : les Girondins et les
Montagnards. Les Montagnards, plus durs, l'emportent et transforment la
République en dictature : un seul homme est tout-puissant, c'est
Robespierre, qui expédie tout adversaire à la guillotine. Le 27
juillet 1794, il est lui-même guillotiné. La Terreur prend fin.
Une autre Constitution est votée. Elle introduit une nouveauté :
il n'y a plus une seule assemblée, mais deux (c'est encore le cas
aujourd'hui avec l'Assemblée nationale et le Sénat). Mais ce
nouveau régime, le Directoire, est renversé le 9 novembre 1799
par un coup d'État militaire du général Napoléon
Bonaparte.
De l'Empire au retour de la monarchie
Le 2 décembre 1804, Napoléon Ier est
couronné empereur. Tous les pouvoirs sont concentrés entre ses
mains; la République est morte et enterrée. A l'intérieur
du pays, Napoléon réforme le droit en introduisant
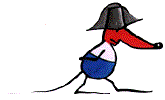 le Code civil et l'enseignement en créant l'Université; à
l'extérieur, il se lance dans une véritable conquête
militaire de l'Europe. En 1815, ses ennemis finissent par l'abattre à
la bataille de Waterloo, en Belgique. Les vainqueurs obtiennent son exil sur
l'île de Sainte-Hélène et favorisent le retour de la
monarchie en France.
le Code civil et l'enseignement en créant l'Université; à
l'extérieur, il se lance dans une véritable conquête
militaire de l'Europe. En 1815, ses ennemis finissent par l'abattre à
la bataille de Waterloo, en Belgique. Les vainqueurs obtiennent son exil sur
l'île de Sainte-Hélène et favorisent le retour de la
monarchie en France.
Les deux frères de Louis XVI vont régner successivement. Le
premier, Louis XVIII, se montre plutôt respectueux des nouvelles
libertés gagnées par la Révolution. Mais à sa mort
en 1824, le second, Charles X, cherche à revenir à une monarchie
plus autoritaire. Ses décisions mécontentent les Français,
et particulièrement les Parisiens.
Nouvelles Révolutions, nouvelle République
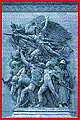 En 1830, pendant trois journées baptisées les "Trois
Glorieuses" (27, 28 et 29 juillet), Paris se révolte et chasse
Charles X. Un nouveau roi monte sur le trône :
Louis-Philippe. C'est un homme modéré, favorable à
certaines libertés. En 1848, les manifestations de mécontentement
se multiplient. Le 22 février, à Paris, une nouvelle
Révolution contraint le roi à abdiquer. La Seconde
République est proclamée.
En 1830, pendant trois journées baptisées les "Trois
Glorieuses" (27, 28 et 29 juillet), Paris se révolte et chasse
Charles X. Un nouveau roi monte sur le trône :
Louis-Philippe. C'est un homme modéré, favorable à
certaines libertés. En 1848, les manifestations de mécontentement
se multiplient. Le 22 février, à Paris, une nouvelle
Révolution contraint le roi à abdiquer. La Seconde
République est proclamée.
Cette fois, on décide d'élire les nouveaux représentants
du peuple au suffrage universel : 7 800 000 hommes votent, et non plus
seulement 250 000 comme auparavant ! Néanmoins, la plupart des
ministres viennent de la bourgeoisie. Ils se méfient du petit peuple. En
juin 1848, des manifestations d'ouvriers sont durement
réprimées.
C'est aussi la Seconde République qui invente l'élection du
président de la République au suffrage universel. Le premier
président de l'histoire est élu en 1848. Il s'appelle
Louis-Napoléon Bonaparte. Comme son cousin
Napoléon Ier, il utilise la force en 1851 pour mettre
fin à la République. Un an plus tard, il devient empereur sous le
nom de Napoléon III.
La Troisième République : la plus longue de toutes !
Le Second Empire prend fin en 1870 lorsque l'armée impériale est
vaincue à Sedan par la Prusse. Le 4 septembre 1870, la République
est proclamée à Paris. Une république très rigide
qui commence par faire massacrer les révoltés parisiens de la
Commune (mars-mai 1871). En fait, les hommes au pouvoir n'attendent qu'une
occasion pour rétablir un roi ou un empereur : mais qui ? Un
descendant de Charles X ? De Louis-Philippe ? De Napoléon
III ? Finalement, personne ne sait s'imposer et trois lois sont
votées de justesse en 1875 qui donnent à la Troisième
République une Constitution. Prévue pour n'être
qu'éphémère, elle durera jusqu'en 1940 !
Le pouvoir de voter les lois est accordé au Parlement composé de
deux assemblées, la Chambre des députés (élue pour
4 ans au suffrage universel) et le Sénat (élu au suffrage
indirect). Le président de la République, élu par le
Parlement pour 7 ans, ne jouit pas d'un pouvoir très étendu; il
peut juste dissoudre le Parlement et provoquer de nouvelles élections.
Utilisé une fois par le président Mac-Mahon, ce droit ne le sera
plus par la suite.
Néanmoins, la République se fortifie et adopte des
réformes ambitieuses comme la création de l'école
laïque, gratuite et obligatoire (1880-81) ou la séparation de
l'Eglise et de l'État en 1905.
L'époque est aussi marquée par la condamnation à tort du
capitaine Dreyfus, accusé de haute trahison en 1894. Cette fameuse
"affaire Dreyfus" divise la société en deux camps; il sera
pourtant gracié et réhabilité en 1906, après
plusieurs années de bagne.
D'une guerre à l'autre
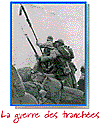 En 1914, la France entre dans une guerre épuisante qui dure 4 ans et met
l'Europe à feu et à sang. Mais la République endure
l'épreuve. L'après-guerre est marquée par l'arrivée
de deux gouvernements de gauche, en 1924 (le "Cartel des gauches") et en 1936,
le Front populaire. Aucun ne dure très longtemps. En 1939, c'est
à nouveau la guerre qui ne prend son ampleur terrible qu'une
année plus tard. L'armée française est battue en quelques
semaines et, le 10 juillet 1940, les députés (sauf 80 d'entre
eux) confient tous les pouvoirs à un gouvernement sous l'autorité
du maréchal Philippe Pétain. Ce jour marque la fin de la
IIIe République et l'installation d'un régime
autoritaire, l'État français, collaborant de plus en plus activement
avec l'Allemagne nazie qui occupe une partie du pays.
En 1914, la France entre dans une guerre épuisante qui dure 4 ans et met
l'Europe à feu et à sang. Mais la République endure
l'épreuve. L'après-guerre est marquée par l'arrivée
de deux gouvernements de gauche, en 1924 (le "Cartel des gauches") et en 1936,
le Front populaire. Aucun ne dure très longtemps. En 1939, c'est
à nouveau la guerre qui ne prend son ampleur terrible qu'une
année plus tard. L'armée française est battue en quelques
semaines et, le 10 juillet 1940, les députés (sauf 80 d'entre
eux) confient tous les pouvoirs à un gouvernement sous l'autorité
du maréchal Philippe Pétain. Ce jour marque la fin de la
IIIe République et l'installation d'un régime
autoritaire, l'État français, collaborant de plus en plus activement
avec l'Allemagne nazie qui occupe une partie du pays.
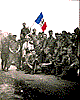 Dès le 18 juin 1940, sur les ondes anglaises de la BBC, le
général De Gaulle refuse l'armistice et encourage les
Français à poursuivre la lutte. Il va s'efforcer de reconstituer
une armée - les Forces françaises libres - et d'unir les divers
mouvements de résistance au sein du Conseil national de la
résistance. De là naîtront les futures institutions
républicaines.
Dès le 18 juin 1940, sur les ondes anglaises de la BBC, le
général De Gaulle refuse l'armistice et encourage les
Français à poursuivre la lutte. Il va s'efforcer de reconstituer
une armée - les Forces françaises libres - et d'unir les divers
mouvements de résistance au sein du Conseil national de la
résistance. De là naîtront les futures institutions
républicaines.
La Quatrième République : la mal-aimée
 En 1945, la guerre prend fin et les Français sont invités
à exprimer leurs souhaits pour l'avenir : veulent-ils revenir au
régime de la Troisième République ? Non,
répondent-ils lors d'un référendum. Un premier projet de
constitution est rejeté; un second est adopté. Elle entre en
application le 27 octobre 1946. Un changement essentiel est à noter :
depuis 1945, le suffrage est réellement universel puisque les femmes
sont autorisées à voter.
En 1945, la guerre prend fin et les Français sont invités
à exprimer leurs souhaits pour l'avenir : veulent-ils revenir au
régime de la Troisième République ? Non,
répondent-ils lors d'un référendum. Un premier projet de
constitution est rejeté; un second est adopté. Elle entre en
application le 27 octobre 1946. Un changement essentiel est à noter :
depuis 1945, le suffrage est réellement universel puisque les femmes
sont autorisées à voter.
En vérité, le nouveau régime ressemble à l'ancien :
le président de la République est effacé; le
président du Conseil - l'équivalent du Premier ministre - exerce
le pouvoir mais son gouvernement peut être renversé à tout
moment par le Parlement (composé d'une Assemblée nationale et
d'un Conseil de la République). Cette constitution favorise les
alliances - souvent provisoires - entre partis politiques. Résultat :
personne ne conduit fermement le pays, alors que la France traverse une
période difficile, aggravée par la guerre en Indochine et en
Algérie, deux territoires français entrés en
révolte pour obtenir leur indépendance. Le 13 mai 1958, une
émeute éclate à Alger. Pour rétablir l'ordre, le
président de la République appelle Charles De Gaulle au
gouvernement. Mais De Gaulle, qui depuis le début critique la
Constitution de 1946, obtient la rédaction d'un nouveau texte.
Adopté par référendum, il entre en vigueur le 4 octobre
1958 : de ce jour date donc le baptême de la Ve
République.
La Cinquième République
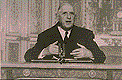 Les débuts de la nouvelle république ne sont pas des plus faciles.
En effet, il faut d'abord gérer la décolonisation, c'est-à-dire
l'indépendance des ex-colonies. Le 18 mars 1962, la guerre d'Algérie prend
officiellement fin lors de la conférence d'Évian. Élu président
en 1958 après le référendum sur la Constitution, le Général
De Gaulle veut faire de la France une grande puissance autonome: il fait développer
une bombe atomique française et fait fermer les bases militaires américaines
en France. Cependant, il est surpris par les "événements" de mai 68
pendant lesquels de nombreuses manifestations éclatent, rassemblant des étudiants
mais aussi des ouvriers. En 1969, il propose une réforme du Sénat par
référendum; 53,3% des Français la refusent. Charles de Gaulle
démissionne alors et se retire dans le village de Colombey-les-deux-Eglises
où il s'éteint le 9 novembre 1970.
Les débuts de la nouvelle république ne sont pas des plus faciles.
En effet, il faut d'abord gérer la décolonisation, c'est-à-dire
l'indépendance des ex-colonies. Le 18 mars 1962, la guerre d'Algérie prend
officiellement fin lors de la conférence d'Évian. Élu président
en 1958 après le référendum sur la Constitution, le Général
De Gaulle veut faire de la France une grande puissance autonome: il fait développer
une bombe atomique française et fait fermer les bases militaires américaines
en France. Cependant, il est surpris par les "événements" de mai 68
pendant lesquels de nombreuses manifestations éclatent, rassemblant des étudiants
mais aussi des ouvriers. En 1969, il propose une réforme du Sénat par
référendum; 53,3% des Français la refusent. Charles de Gaulle
démissionne alors et se retire dans le village de Colombey-les-deux-Eglises
où il s'éteint le 9 novembre 1970.
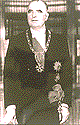 Le président Pompidou poursuit les grandes lignes de la politique de son
prédécesseur. Il meurt le 2 avril 1974, avant d'avoir terminé son mandat
(qui est de 7 ans).
Le président Giscard d'Estaing lui succède. Peu après, au milieu des
années 70, la crise économique frappe le pays. C'est ce qu'on a appelé
le premier " choc pétrolier ". Le 10 mai 1981, les Français mécontents
élisent François Mitterrand à la présidence de la République:
c'est le premier président socialiste de la Ve République. Avec lui, la gauche
fait son retour à la tête de l'État. Le nouveau gouvernement dirigé
par Pierre Mauroy adopte la 5ème semaine de congés payés et nationalise
plusieurs entreprises. Les socialistes restent au gouvernement jusqu'en 1993, à
l'exception des années 1986 à 1988 qualifiées de période
de "cohabitation".
Le président Pompidou poursuit les grandes lignes de la politique de son
prédécesseur. Il meurt le 2 avril 1974, avant d'avoir terminé son mandat
(qui est de 7 ans).
Le président Giscard d'Estaing lui succède. Peu après, au milieu des
années 70, la crise économique frappe le pays. C'est ce qu'on a appelé
le premier " choc pétrolier ". Le 10 mai 1981, les Français mécontents
élisent François Mitterrand à la présidence de la République:
c'est le premier président socialiste de la Ve République. Avec lui, la gauche
fait son retour à la tête de l'État. Le nouveau gouvernement dirigé
par Pierre Mauroy adopte la 5ème semaine de congés payés et nationalise
plusieurs entreprises. Les socialistes restent au gouvernement jusqu'en 1993, à
l'exception des années 1986 à 1988 qualifiées de période
de "cohabitation".
Le 7 mai 1995, Jacques Chirac est élu président de la République;
il nomme Alain Juppé comme Premier ministre.
Les symboles
Le coq : plus gaullien que gaulois
 Gaulois, le coq ? Hum, pas vraiment. Nos ancêtres n'avait pas
d'amour particulier pour ce volatile. C'est aux Romains qu'on doit le premier
rapprochement entre les habitants de la Gaule et l'orgueilleux
emplumé... tout simplement parce qu'en latin, "gallus" signifie à
la fois "coq" et "gaulois" ! De-ci, de-là, sur une monnaie ou une
gravure, les rois de France lui font une petite place, mais il demeure un
emblème mineur.
Gaulois, le coq ? Hum, pas vraiment. Nos ancêtres n'avait pas
d'amour particulier pour ce volatile. C'est aux Romains qu'on doit le premier
rapprochement entre les habitants de la Gaule et l'orgueilleux
emplumé... tout simplement parce qu'en latin, "gallus" signifie à
la fois "coq" et "gaulois" ! De-ci, de-là, sur une monnaie ou une
gravure, les rois de France lui font une petite place, mais il demeure un
emblème mineur.
A la Révolution, le coq sort enfin de l'ombre et devient animal
fétiche. Pour peu de temps. L'empereur Napoléon le renvoie dans
sa basse-cour car il préfère d'autres plumes et un autre bec :
ceux de l'aigle.
Le coq revient avec la République : il s'installe même à
l'Elysée, la résidence du président de la
République, sous la forme d'une sculpture dans la grille du palais -
cette "grille du coq" est toujours là.
Mais c'est finalement pendant la Première Guerre mondiale que le coq
devient une vedette. Les caricaturistes français l'adorent. Il symbolise
alors la France, paysanne et courageuse, face à l'aigle cruelle (*)
choisie comme emblème par l'empereur allemand. Depuis, il est devenu
l'un des symboles non officiels mais indémodables de la
République : quand en 1944 le général de Gaulle fait
imprimer à Alger les premiers timbres de la France
libérée, il fait dessiner un coq chantant le cocorico de la
victoire !
Et lorsque l'équipe de France de football ou de rugby joue, il suffit
souvent de scruter le stade pour trouver, sur un coin de pelouse, un vrai coq
en chair et en plumes lâché par un spectateur malicieux.
(*) en héraldique, aigle s'écrit au féminin.
La Marseillaise : elle aurait pu s'appeler la Strasbourgeoise !
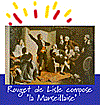 "Aux armes citoyens, formez vos bataillons..." Chacun en fredonne le
refrain, mais qui en connaît vraiment les paroles ? Et d'abord,
saviez-vous que la Marseillaise compte sept longs couplets, tous
composés d'une seule traite et en une seule nuit par un soldat, le
capitaine Claude-Joseph Rouget de Lisle, en garnison à Strasbourg ?
Le 26 avril 1792, ce morceau de bravoure est chanté avec lyrisme par le
maire de la ville : il plaît énormément, mais à
l'époque il s'intitule encore "Chant de guerre pour l'armée du
Rhin".
"Aux armes citoyens, formez vos bataillons..." Chacun en fredonne le
refrain, mais qui en connaît vraiment les paroles ? Et d'abord,
saviez-vous que la Marseillaise compte sept longs couplets, tous
composés d'une seule traite et en une seule nuit par un soldat, le
capitaine Claude-Joseph Rouget de Lisle, en garnison à Strasbourg ?
Le 26 avril 1792, ce morceau de bravoure est chanté avec lyrisme par le
maire de la ville : il plaît énormément, mais à
l'époque il s'intitule encore "Chant de guerre pour l'armée du
Rhin".
On aurait pu tout autant l'appeler la Strasbourgeoise. Mais l'histoire en
décida autrement.
Le 30 juillet 1792, une troupe de 500 hommes pénètre dans Paris
en chantant à tue-tête un air martial et entraînant qui
n'est autre que... le chant de Rouget de Lisle ! Comme ce bataillon vient
de Marseille pour participer à la Révolution, la chanson est
prestement rebaptisée "la Marseillaise" par les Parisiens. Le
succès est foudroyant. Dès le 14 juillet 1795, il devient hymne
national.
Mais quand la Révolution prend fin avec l'avènement de l'empereur
Napoléon, puis le retour de la monarchie, la Marseillaise est
oubliée. C'est seulement le retour de la République,
troisième du nom, qui confirme son statut d'hymne national en 1879.
Depuis, elle ne l'a jamais perdu. "Aux armes citoyens, formez vos
bataillons..."
Marianne : la femme-République
 On lui donne les traits de Brigitte Bardot, Catherine Deneuve ou Sophie
Marceau. À qui ? À Marianne, cette figure féminine
qui symbolise la République, avec son bonnet phrygien sur la tête.
Dans l'Antiquité déjà, la démocratie était
représentée par une femme; et dans l'empire romain, le bonnet
phrygien était synonyme de liberté puisque les anciens esclaves
affranchis par leur maître le portaient. En 1792, quand la
Révolution française accouche de la Ire
République, c'est une femme qu'on choisit pour symboliser le nouveau
régime, une guerrière souvent casquée. Le bonnet phrygien
remplacera peu à peu le casque. Quant à son nom, il vient des
adversaires de la République qui, pour ridiculiser ce régime
populaire, choisissent deux prénoms très répandus dans le
petit peuple : Marie et Anne. Par un amusant retournement de situation, le
sobriquet s'est imposé.
On lui donne les traits de Brigitte Bardot, Catherine Deneuve ou Sophie
Marceau. À qui ? À Marianne, cette figure féminine
qui symbolise la République, avec son bonnet phrygien sur la tête.
Dans l'Antiquité déjà, la démocratie était
représentée par une femme; et dans l'empire romain, le bonnet
phrygien était synonyme de liberté puisque les anciens esclaves
affranchis par leur maître le portaient. En 1792, quand la
Révolution française accouche de la Ire
République, c'est une femme qu'on choisit pour symboliser le nouveau
régime, une guerrière souvent casquée. Le bonnet phrygien
remplacera peu à peu le casque. Quant à son nom, il vient des
adversaires de la République qui, pour ridiculiser ce régime
populaire, choisissent deux prénoms très répandus dans le
petit peuple : Marie et Anne. Par un amusant retournement de situation, le
sobriquet s'est imposé.
Le drapeau : trois couleurs qui font la France
 Bleu, blanc, rouge : aucun doute, ces trois couleurs sont attachées à notre pays ;
d'ailleurs la Constitution reconnaît le drapeau tricolore comme emblème national.
Mais d'où viennent-elles donc ? De... loin ! Lors du couronnement de Charlemagne, il y a
1200 ans, une bannière bleue flottait déjà en hommage à saint Martin,
qui coupa son manteau bleu en deux pour en offrir une moitié à un pauvre. Le rouge,
couleur du sang des martyrs, vient de saint Denis dont les rois de France firent le protecteur
du royaume. Quant au blanc, il est choisi comme couleur royale en 1638. La Révolution
française prend ces trois couleurs et les réunit sur un même drapeau dès
1790. Depuis, malgré quelques tentatives de changement, il n'a pas bougé.
Bleu, blanc, rouge : aucun doute, ces trois couleurs sont attachées à notre pays ;
d'ailleurs la Constitution reconnaît le drapeau tricolore comme emblème national.
Mais d'où viennent-elles donc ? De... loin ! Lors du couronnement de Charlemagne, il y a
1200 ans, une bannière bleue flottait déjà en hommage à saint Martin,
qui coupa son manteau bleu en deux pour en offrir une moitié à un pauvre. Le rouge,
couleur du sang des martyrs, vient de saint Denis dont les rois de France firent le protecteur
du royaume. Quant au blanc, il est choisi comme couleur royale en 1638. La Révolution
française prend ces trois couleurs et les réunit sur un même drapeau dès
1790. Depuis, malgré quelques tentatives de changement, il n'a pas bougé.
retour en haut
|
Elections Présidentielles
Mandat de
Nicolas Sarkozy
Résultats
Elections Législatives
XIIIe législature :
Majorité UMP
Détails
Présidence

Gouvernement

Assemblée Nationale

Sénat

Journal Officiel

Légifrance

Service Public

|
|

